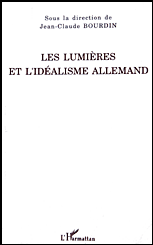
Du législateur au public éclairé : l’histoire du progrès politique chez Rousseau, Kant et Fichte
In J.C. Bourdin (dir.) Les Lumières et l’idéalisme allemand, actes du colloque de Poitiers, C.R.H.I.A., L’Harmattan 2007, pp. 91-99.
Texte intégral
Si l’on devait ne donner qu’une notion pour penser ensemble les Lumières et l’Aufklärung, ce serait très certainement celle d’émancipation. Émancipation, c’est-à-dire non seulement liberté mais libération, modalités de réalisation de la liberté dans le monde. On pourrait presque s’arrêter là pour ce qui est des points communs aux Lumières françaises et allemandes, puisqu’il nous faudrait de suite opposer la liberté des Lumières, brillamment illustrée par l’irréligion et la matérialisme de l’Encyclopédie, et la liberté de l’Aufklärung qui ne se résume pas au « spinozisme » d’un Lessing, mais se situe du côté de la foi, quitte à définir cette foi par un nouvel usage, pratique, de la raison. L’opposition est moindre concernant non plus la liberté elle-même mais la libération, du moins la pensée de cette libération. Que l’on soit français ou allemand il s’agit toujours d’un développement conjoint de la raison et de la liberté, développement qui voit dans une transformation du politique les moyens de son accomplissement.
Que le développement de la raison et celui de la liberté soient conjoints paraît tout d’abord simplifier la notion d’émancipation et en produire la définition réelle, celle qui exprime les conditions de sa réalisation, en liant raison et liberté. On voit mal en effet pourquoi viser une liberté sans raison, et la raison sans liberté se développe peu : elle été illustrée par l’obscurantisme des époques « antérieures ». La notion même d’obscurantisme nous fait comprendre qu’il est bien difficile de définir la raison sans la liberté, et que subordonnée à des exigences étrangères, la raison se trouve vite limitée dans son usage, ne peut être appelée faculté des principes et sert tout au plus à subordonner des moyens à des fins. Il en va au fond de même de la liberté, puisqu’une liberté sans raison aurait bien du mal à se distinguer d’un simple accomplissement des passions primitives, ou de la passion primitive si je me réfère déjà à Rousseau. L’amour de soi comme seul principe de la conduite ne permet pas de distinguer l’homme de l’animal, et la simple capacité d’acquiescer ou de résister au commandement de la nature ne permet pas de distinguer le comportement des premiers humains d’avec celui d’un animal combinant quelques idées, comme les corneilles ou les singes[1]. Pas de développement de la raison sans liberté, pas de liberté véritablement humaine sans viser des fins proposées par la raison.
Mais la simplicité apparente de notre notion d’émancipation se renverse alors en une complexité qui rend bien difficile la pensée de son développement effectif. Si développement de la raison et réalisation de la liberté sont si étroitement liés, « l’initiation » de ce développement devient incompréhensible. Nous ne pouvons ni développer la raison par une liberté qui ne serait alors qu’une liberté sans raison, ni exercer notre liberté grâce à une raison encore immature. Cette difficulté est au cœur de la notion d’émancipation, et mon intervention veut montrer qu’elle a été appréhendée et résolue progressivement, de façon continue, en partant des Lumières et particulièrement de Rousseau, pour se retrouver dans l’Aufklärung ou du moins chez un philosophe qui s’y rapporte, Kant, puis un autre que l’on peut y rapporter, Fichte, et notamment lorsque ceux-ci abordent la question de la transformation du politique, et qu’ils envisagent donc la réalisation de l’État idéal constitué dans leur philosophie politique, État qui a pour tâche de se trouver sur la voie du développement conjoint de la liberté et de la raison.
ROUSSEAU
Rousseau, premier auteur de cette intervention, aborde à plusieurs reprises la question de la réalisation effective de son État idéal. Qu’il s’agisse de la fin du Discours sur l’inégalité ou du Contrat social I 6, l’institution historique du politique légitime part toujours d’un état de guerre où ne règnent que la force et l’amour-propre des propriétaires. Qu’il s’agisse de la dernière étape de l’état de nature ou de la dernière étape de la dégénérescence des sociétés politiques historiques, dans les deux cas la prise en compte de la dégradation réelle des rapports humains paraît être, venant d’un philosophe, un gage de réalisme. Elle met en fait le théoricien face à une difficulté insurmontable : qui, au sein de cette dégénérescence, non seulement passera le contrat, mais même aura l’idée d’un contrat susceptible de fonder un État légitime et durable ? Le contrat présenté comme effectif (historique) dans le Discours sur l’inégalité est proposé par le riche. Sans rentrer dans les querelles d’interprétations concernant le caractère juridiquement valide ou non de ce contrat, il est certain que le riche institue l’État dans le but de le détourner à son profit. Cette institution-là ne peut donc être celle d’un État durable, témoin en est la dégénérescence nécessaire du politique, dégénérescence qui est bien, par opposition à celle de l’état de nature, déductible de son origine, enveloppée par l’égoïsme des propriétaires.
Pour instituer un État légitime et durable il faudrait pouvoir échapper à la dégénérescence de l’espèce. Certains individus échappent bien chez Rousseau à la dégénérescence de l’espèce et sont effectivement « éclairés »[2] par le développement des sciences et des arts. Nous savons que des individus éclairés peuvent prendre en charge la rédaction des lois fondamentales et entreprendre par là « d’instituer un peuple », ils remplissent alors la fonction du législateur, auquel Rousseau consacre le chapitre sept du L. II du Contrat social. Une fois précisée la spécificité de sa fonction, Rousseau met le législateur face à la difficulté centrale présentée en introduction : comment initier le développement de la raison et de la liberté si chacune a besoin de l’autre pour son propre développement ? Comment faire comprendre à des individus dont majoritairement la raison n’est pas encore suffisamment développée, et pour qui « les vues trop générales et les objets trop éloignés » sont hors de portée, que le bien commun, objet général visé par les nouvelles institutions, doit être respecté et qu’il ne fait qu’un avec le véritable bien de chacun ?
Il y a là un vrai problème puisque c’est seulement en passant par l’état civil que les facultés humaines de ces individus se développeront. Il ne s’agit pas seulement de convaincre les individus égoïstes, propriétaires ou non, qu’ils n’ont rien à perdre dans l’état civil. De fait, les pauvres sauvent leur vie, les propriétaires, et leur vie et leurs biens, ces derniers ont fait un « échange avantageux »[3] en rentrant dans l’état civil, la thématique est connue. Il s’agit pour le législateur de faire du politique un moyen de l’émancipation, un milieu du développement conjoint de la raison et de la liberté. Le législateur institue l’état civil qu’annonce le célèbre chapitre huit du livre I du Contrat social état qui est tout à la fois milieu et moyen de développement. A cette fin, on peut toujours prendre appui sur l’intérêt privé pour convaincre les propriétaires de souscrire au pacte social, mais il faut aussi et surtout infléchir cet intérêt particulier, engager les volontés à respecter les lois avant qu’elles puissent se rapporter spontanément à cet objet général qu’est le bien commun :
« Pour qu'un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique et suivre les règles fondamentales de la raison d'État, il faudrait que l'effet pût devenir la cause, que l'esprit social[[4]] qui doit être l'ouvrage de l'institution présidât à l'institution même, et que les hommes fussent avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles »[5]
Le législateur doit engager les volontés sans employer, écrit Rousseau, ni la force ni le raisonnement, puisqu’il serait dans un cas en deçà du politique, et dans l’autre au-delà. Le recours à la religion est la réponse donnée dans le texte, pour renforcer le caractère obligatoire des lois civiles lors de l’institution de l’État. La singularité du législateur n’est plus alors seulement celle d’un individu éclairé, elle est aussi due à la grandeur des moyens à employer pour accomplir sa tâche. Médiation entre l’humain et le divin, la supériorité du législateur est ici redoublée par la transcendance du religieux qu’il est censé exprimer. Avec cette transcendance, il est plus que jamais question de dire que la libération ne peut venir que d’en haut. Cette dernière thématique est commune aux trois auteurs étudiés, mais l’exposé rousseauiste de la difficulté initiale du progrès politique renforce cette situation au moins paradoxale du citoyen, ainsi dépossédé du sens et des moyens de sa propre émancipation.
Kant
Les nuances apportées par la reprise allemande de l’émancipation rousseauiste permettront peut-être de réduire cette dépossession, et par là la contradiction qu’il y a, non seulement à libérer autrui, mais à le libérer en le dominant. Il s’agit bien d’une reprise de la même thématique, en des termes quasiment identiques, mais la difficulté se trouve maintenant illustrée tant dans le registre politique que dans le registre éducatif[6]. Nous retrouvons donc « le problème le plus difficile qui puisse être proposé à l’homme »[7], tout à la fois dans les Réflexions sur l’éducation (ou Propos de pédagogie, selon les traductions), mais également dans l’Idée d’une histoire universelle (titre de la 6e proposition). La formulation kantienne de ce problème est que les lumières[8] dépendent de l’éducation et celle-ci à son tour des lumières. Le cercle de l’éducateur éduqué est l’exacte reprise du peuple instituant institué, cercle que Rousseau brisait en posant un législateur transcendant. Kant évoque aussi la possibilité de briser le cercle de l’éducateur éduqué en faisant appel à un éducateur transcendant : « si seulement un être d'une nature supérieure se chargeait de notre éducation, on verrait alors ce qu'on peut faire de l'homme »[9]. Mais cet appel n’est qu’un vœu pieux. Et en considérant l’histoire effective de l’humanité, la difficulté apparaît sans autre solution que celle d’un effort infini redressant l’espèce, à chaque génération, du dévoiement constamment répété de sa destination. C’est la voie choisie tant dans la suite du texte des Réflexions sur l’éducation, que dans l’Anthropologie, II E[10], où Kant part à nouveau du cercle de l’éducateur éduqué pour exposer les difficultés du développement des facultés humaines et conclure au caractère insoluble du problème de l’éducation morale : « Il faut donc éduquer l’homme en vue du bien ; or, son éducateur est à son tour un homme enfermé dans la brutalité de la nature et, dans cette situation, on attend de lui qu’il accomplisse ce dont lui-même a besoin. De là le constant dévoiement […] »[11].
Sans recourir à une intervention transcendante, le problème paraît sans solution, du moins dans le domaine éducatif. Il n’en va pas tout à fait de même dans le politique. La nécessité, exposée dans la sixième proposition de l’Idée d’une histoire universelle, de choisir un chef au sein de l’espèce humaine, retient la solution de notre difficulté en deçà de toute transcendance. Certes, le texte de la sixième proposition récuse toute solution parfaite, mais la huitième proposition du même opuscule, défendant la liberté civile, fait appel au rôle positif des lumières[12] pour favoriser, en influençant les gouvernants, l’établissement d’une situation cosmopolitique universelle. Dans l’Idée d’une histoire universelle, le développement des lumières apparaît donc lui-même comme solution au moins partielle au développement des lumières. L’opuscule qui répond à la question Qu’est-ce que les Lumières ? nous explique comment cette tautologie devient une solution : un public peut s’éclairer lui-même. Par « public » ici il faut entendre vous le savez, le public savant c’est-à-dire le public qui lit, qui se lit et pour qui l’on publie, mais il faut aussi entendre, pour souligner cette capacité d’autoéducation, une communauté.
Dans une communauté,
« Il se trouvera toujours quelques êtres pensant par eux mêmes, même parmi les tuteurs attitrés de la masse, pour rejeter eux-mêmes le joug de la minorité et pour propager autour d’eux l’esprit d’une estimation raisonnable de la propre valeur et de la vocation de tout homme à penser par soi-même »[13]
C’est donc la pluralité des individus en communauté qui permet de briser le cercle de l’éducateur éduqué. Elle prend la place de celui qui possède déjà raison et liberté. Plus exactement c’est en prenant en compte un nombre suffisamment important de personnes que l’on peut espérer trouver parmi ces personnes un homme suffisamment éclairé pour répandre les Lumières autour de lui. Mais ce ou ces personnes déjà éclairées ne constituent pas une transcendance nouvelle, c’est en tant que membres d’une communauté qu’ils sont trouvés, et c’est en tant que tels qu’ils viennent expliquer la possibilité qu’un public « s’éclaire lui-même » - ein Publicum sich selbst aufkläre. L’autoéducation de la communauté est clairement posée dans le texte kantien. Certes il ne s’agit pas d’une autodétermination politique, et les lumières développées doivent être portées devant le trône. Mais il s’agit quand même, à l’instar du texte le plus démocratique d’Aristote – je pense au chapitre onze du livre III des Politiques – d’une confiance accordée au plus grand nombre, en reconnaissant qu’il recèle des personnes de valeur et dont la valeur s’accroît et retentit sur le tout lorsqu’elle est mise en commun.
Fichte.
Fichte radicalise la position kantienne tout en l’explicitant. Si l’on peut trouver chez Kant l’affirmation d’un rôle fondamental joué par la communauté elle-même, il reste en effet à comprendre l’existence en son sein de personnes déjà éclairées. Chez Fichte l’explication de cette présence fournit en même temps l’explication du développement des lumières : la communauté n’est plus seulement le lieu dans lequel se trouve certainement, compte tenu de la masse humaine en présence, des individus déjà éclairés, mais la communauté est devenue milieu même de développement des lumières, en considérant la communauté de façon qualitative et dynamique, comme échange. Fichte est en effet le promoteur d’une théorie de l‘intersubjectivité aux consonances contemporaines, maintenant très commentée, parce qu’il construit la conscience de soi dans l’intersubjectivité. Les premiers textes consacrés spécifiquement à la philosophie du droit d’une part et à la philosophie morale de l’autre développent tous deux le statut fondamental de cette intersubjectivité[14]. Pourtant, la position fondamentale de l’intersubjectivité ne s’illustre d’emblée ni dans le juridico-politique, ni dans l’éthique, mais dans l’éducation[15]. C’est en termes d’éducation que s’exprime la nécessité dans laquelle se trouve chaque sujet humain de rentrer en rapport à autrui pour prendre conscience de lui-même comme sujet humain, et donc pour exister comme sujet libre. Prendre conscience de sa liberté requiert que ma liberté soit objet de ma conscience, elle ne peut pourtant m’être donnée de l’extérieur, et doit donc m’être présentée comme une invitation – appel ou sollicitation – à agir librement. Voilà posée l’intersubjectivité. La détermination de l’intersubjectivité reste au plus proche de son sens fondamental, où l’un et l’autre font réciproquement exister leur liberté. Cette relation implique que l’un s’adresse à l’autre selon des modalités qui ne puissent nullement le contraindre et dont la visée soit comprise, comme telle, et par l’un et par l’autre. Liberté et raison vont donc ici de pair. Je ne puis respecter la liberté de l’autre qu’en m’adressant à lui au moyen d’une raison commune et en présupposant qu’il comprend cet appel. La matière de cette relation n’est ni rapport physique, ni coexistence indifférente des corps et des arbitres, mais dialogue, échange de concepts :
« C'est uniquement la libre action réciproque à l'aide de concepts et selon des concepts, uniquement le fait de dispenser et celui de recevoir des connaissances, qui forment le caractère propre de l'humanité, par lequel seulement chaque personne se confirme indiscutablement dans son humanité »[16]
Ici la conscience de soi-même comme d’un être libre se réalise dans et par l’exercice de la raison, mais en partant de la liberté et pour affirmer sa liberté. L’existence en communauté est donc fondamentale et fondamentalement déterminée comme intersubjectivité constitutive de la liberté et de la conscience de soi des sujets humains. C’est pour permettre l’existence de cette communauté que Fichte déduit l’État – alors État de raison – en commandant ses institutions par le respect de la liberté de chacun[17]. Toutefois, c’est clair, Fichte n’est pas démocrate. Il ne l’est ni au sens strict, puisqu’il identifie démocratie absolue et despotisme, ni même peut être au sens large, puisque - ce qui est peut-être un gage de réalisme politique - il ramasse l’essentiel du pouvoir effectif dans les mains de l’exécutif. Le statut fondamental de la liberté est néanmoins préservé dans la construction fichtéenne par l’attachement de la souveraineté à la communauté, au « peuple tout entier »[18], grâce à cet artifice institutionnel qu’est « l’éphorat ». Cet artifice autorise un conseil de quelques sages à convoquer le représenté si le représentant ne remplit plus sa fonction. En permettant ainsi de manifester juridiquement l’existence de la communauté, l’éphorat est ce qui rend toute constitution légitime. On comprend – en tout cas mieux que chez Kant – comment la communauté politique fait encore, en commandant l’obéissance au représentant en place, œuvre de liberté.
Mais il s’agit là de l’État de raison. Pour ce qui est du rapport des États de fait – les États de nécessité – à l’État de raison, Fichte retrouve dès le Système de l’éthique, malgré les Considérations sur la Révolution française, les accents plus modérés de la philosophie politique kantienne. Nous retrouvons l’usage public de la raison comme seul palladium des droits du peuple : il y aurait contradiction à renverser les États de faits au nom de la liberté commune, puisque cette dernière s’exprime déjà, en principe, par la voie du pouvoir commun. Cette contradiction se résout en déplaçant l’expression de ma liberté, opposée au pouvoir commun, au sein d’une communauté intermédiaire, communauté des savants, qui prend à son tour à charge, par les lumières qu’elle répand sur tout le peuple, de faire progresser l’État de fait vers l’État de raison. Au sein de la communauté des savants règne déjà une liberté commune, surtout en ce qui concerne l’expression des idées de chacun sur la chose publique. Lorsque ces lumières se répandent sur la nation, il y a évolution et non révolution d’un peuple éclairé vers l’État de raison, dans la mesure où l’administration de l’État est elle-même imprégnée de culture savante, voire fait elle-même partie de cette communauté des savants[19]. Parti d’une invitation réciproque à agir librement qui prenait corps dans un échange de connaissances au sein d’un public savant, nous retrouvons donc finalement une figure proche du philosophe roi ou du roi philosophe.
Malgré les premiers efforts fichtéens présentant la constitution immanente de la liberté au sein de l’intersubjectivité, c’est finalement encore une raison transcendante qui domine et commande le processus de libération. La raison prime donc encore sur la liberté. C’est aussi je crois une vérité des Lumières, tant françaises qu’allemandes, que de ne pas envisager, sur le plan politique, la réalisation de l’unité fondamentale de la raison et de la liberté dans une démocratie réelle. Le progrès est progressif, et s’il faut de la raison pour le comprendre, il en faut une plus grande encore pour énoncer le sens de sa progression. Cette fonction, qui est celle de la philosophie, retient donc en elle-même la plus haute forme de raison, et n’accorde pas aux processus sociaux la même confiance que lui accordera le siècle suivant. Je pense autant ici à l’idéalisme hégélien et à l’immanence des déterminations dialectiques, qu’au matérialisme marxiste, et à la troisième des Thèses sur Feuerbach, qui fait du moment de la libération – la praxis révolutionnaire ou révolutionnante – l’élément constitutif d’une autoéducation.
[1]. Pour reprendre à mon tour l’exemple que Rousseau reprend à Diderot, dans le Discours sur l’inégalité (Paris, Gallimard, 1970, La Pléiade T. III p. 167). Comme l’a déjà remarqué J. Proust (Diderot et l’Encyclopédie, p. 370), Rousseau s’inspire ici de Diderot, Suite de l’apologie… O.C. IV, Hermann p. 334.
[2]. C’est le terme qu’emploie Rousseau dans la Lettre à Grimm, O.C. III p. 60. La même thématique selon laquelle certains individus échappent à la corruption générale se retrouve in A Philopolis, O.C. III p. 232, et in A Christophe de Beaumont, O.C. IV p. 967.
[3]. Contrat social II 4 : « ils n’ont fait qu’un échange avantageux d’une manière d’être incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre », p. 375.
[4]. Sur cet « esprit social » et son commentaire ultérieur par R. Masters et J.W. Chapmann, cf. L. Vincenti : J.J. Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001, chapitre sept.
[5]. Contrat social II 7 p. 383.
[6]. On peut s’étonner ici que le registre éducatif ne présente pas chez Rousseau cette difficulté sous un même jour. Il a bien été question d’un « despotisme » du précepteur d’Émile, sur lequel nous reviendrons en conclusion, mais ce despotisme, précisément lorsqu’il s’affirme et se veut inflexible, fait tout pour contourner les rapports d’autorité interindividuels. De telle sorte qu’Émile, face à une contrainte qui lui apparaît aussi nécessaire qu’une loi naturelle, développe toujours pour y faire face ses propres facultés. Les artifices pédagogiques du précepteur contournent bien ainsi les apories du progrès politique. On ne peut en politique dissimuler la loi derrière la nature ; le législateur s’inspire de la vraie religion, et il faut de toute façon que le citoyen finisse par reconnaître dans cette loi sa volonté même ; la difficulté de la libération demeure donc.
[7]. Réflexions sur l’éducation, Ak IX 446, p. 77 trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, 1980.
[8]. Le texte dit Einsicht, que l’on pourrait comprendre ici comme la saisie de l’ensemble d’un processus, à partir de l’idéal qu’il doit atteindre.
[9]. Kant, Réflexions sur l'éducation, Ak IX 443, p. 73 trad. A. Philonenko.
[10]. Du caractère de l’espèce.
[11]. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, Ak VII 325-327, Pléiade p. 1136-1138.
[12]. Aufklärung dans le texte.
[13]. Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières ?, Ak VIII 36, trad. fr. J.F. Poirier et F. Proust, Paris, Flammarion, 1991 p. 44, également S. Piobetta, in La philosophie de l'histoire, Paris, Gonthier, coll. Médiations, 1972 p. 47 et in Pléiade II p. 210.
[14]. Fondements du droit naturel selon les principes de la Doctrine de la science, 1796/97, trad. fr. A. Renaut Paris, P.U.F., 1984. Le système de l'éthique selon les principes de la Doctrine de la science, 1798, trad. fr. P. Naulin, Paris, P.U.F., 1986.
[15]. Nous retrouvons ce privilège de l’éducation, plus développé chez Kant et Fichte que chez Rousseau. On peut bien expliquer cette présence du schème éducatif par la position fondamentale de la liberté qui remet la nature humaine entre les mains des hommes eux-mêmes, resterait à comprendre que ce schème soit plus utile chez Kant ou Fichte que chez Rousseau. Peut-être l’éducation ne joue-t-elle pas chez Rousseau le rôle d’un schème de l’émancipation, précisément parce qu’elle est le seul moment de libération effective ?
[16]. Fondement du droit naturel, § 3, trad. fr. p. 55.
[17]. « Chaque individu qui entre dans l’État doit être convaincu qu’il lui est impossible d’être jamais traité contrairement à la loi » Fondement du droit naturel, trad. fr. p. 173.
[18]. Le peuple tout entier, et donc le peuple en corps, unité collective des individus, qui n’existe que dans et par son représentant ; Fondement du droit naturel..., p. 195fr, 179 Meiner, GA I 3, p. 456.
[19]. Cf. la deuxième des Cinq conférences sur la destination du savant, de 1811, trad. fr. J.C. Merle, Cinq Conférences sur la destination du savant dans Opuscules de politique et de morale, Caen, Centre de philosophie politique et juridique de l'Université de Caen, 1989.